Thématique « Traces · Patrimoines · Cultures · Mémoires »
Coordinateurs : Eleni Mouratidou, Claire Scopsi, Marta Severo
Membres à titre principal : Jeanne Ferrari-Giovanangeli, Céline Morin
Membres à titre secondaire : Gilles Bertin, Evelyne Broudoux, Maryse Carmes, Zhao Alexandre Huang, Antonin Segault, Manuel Zacklad
Membres associé.e.s : Romain Bigay, Corinne Nkondjock
Doctorant.e.s : Giuseppe Amapani , Amélie Charles, Irene De Togni, Fabrizio Defilippi, Roch Delannay, Christelle Fanseu , Lucas Fritz, Denys Kolesnyk , Lucile Lamache, Alizé Sibella, Jorge Sosaro, Denis Teyssou, Andreas Verner
Mots-clés : — Environnement / Espace (numériques) — Transmédia, Transmédia documentaire — Dispositifs (numériques) — Édition, Éditotial — Écriture (numérique), Écrilecture — Appropriation / Organisation des connaissances et des informations — Ressource / Collection — Construction / Transmission du sens — Document, Redocumentarisation — Agencements collectifs — Autorité, Autoritativité — Trace (numérique) — Présence (numérique) — Rétention, Mémoire, Oubli — Identité, e-reputation, avatars, données personnelles — Profil, Profilage — Avatar — Identité
Les recherches regroupées dans ce thème se situent dans le prolongement des travaux pionniers qui ont théorisé les processus de redocumentarisation (Zacklad), d'autoritativité (Broudoux), d’éditorialisation collaborative (Barbe) et de traçabilité (Merzeau). Elles portent sur les effets de la traçabilité numérique sur les documents, sur les identités qui leur sont associées et sur les pratiques éditoriales qui les inscrivent dans un environnement informationnel. Interrogeant la co-construction des ressources, des autorités et des modalités de médiation et d'appropriation des connaissances, les travaux ici rassemblés peuvent aussi bien s'intéresser aux réseaux socionumériques qu'aux champs du patrimoine, des archives, de l'édition scientifique, des pratiques pédagogiques, de l'entreprise ou de l'action publique.
Actualités Traces · Patrimoines · Cultures · Mémoires
- quelle gestion des traces pour l’internet des objets ?
- Séance du Jeudi 24 novembre 2022 matin En visio Teams Les archives des objets : quelle gestion des traces pour l’internet des objets ? Lien de la réunion (en cas de difficulté, contacter pour obtenir un lien direct) Cette séance prend la... — En savoir plus

- 31 mai : Valoriser en réseau le patrimoine local
- Séminaire Les nouveaux Paradigmes de l’Archive. Séance du Mardi 31 Mai 2022: En visio Teams Lien de la réunion (en cas de difficulté, contacter pour obtenir un lien direct) — En savoir plus
- Enjeux de l’indexation à l’heure de l’intelligence artificielle
- Séminaire Dicen, thème Editorialisation, patrimonialisation, autorité 9 mars 2022 14h00-17h00 Modalité : présentiel + accès à distance 2 rue Conté Salle 30-1-16 au 1er SOUS SOL dans le « bâtiment » au centre de la cour face au... — En savoir plus
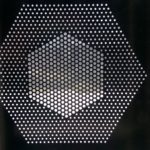
- La conservation des données de la recherche : état de l’art, labels et processus de professionnalisation (séminaire visio) 21 octobre
- Séminaire Les Nouveaux Paradigmes de l’Archive, (organisé par Le Labex Hastec, Le Dicen-idf Cnam Paris, les Archives Nationales et le centre Jean Mabillon de l’Ecole Nationale des Chartes) Jeudi 21 octobre 2021 9h30-11h00, en... — En savoir plus
